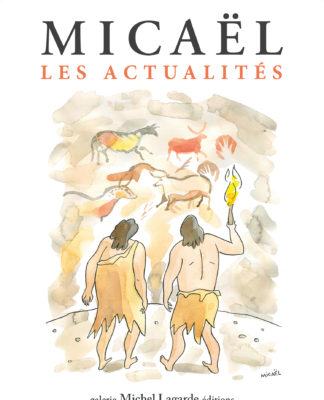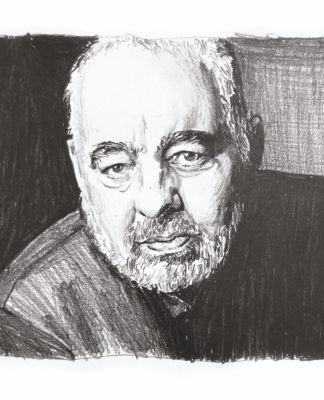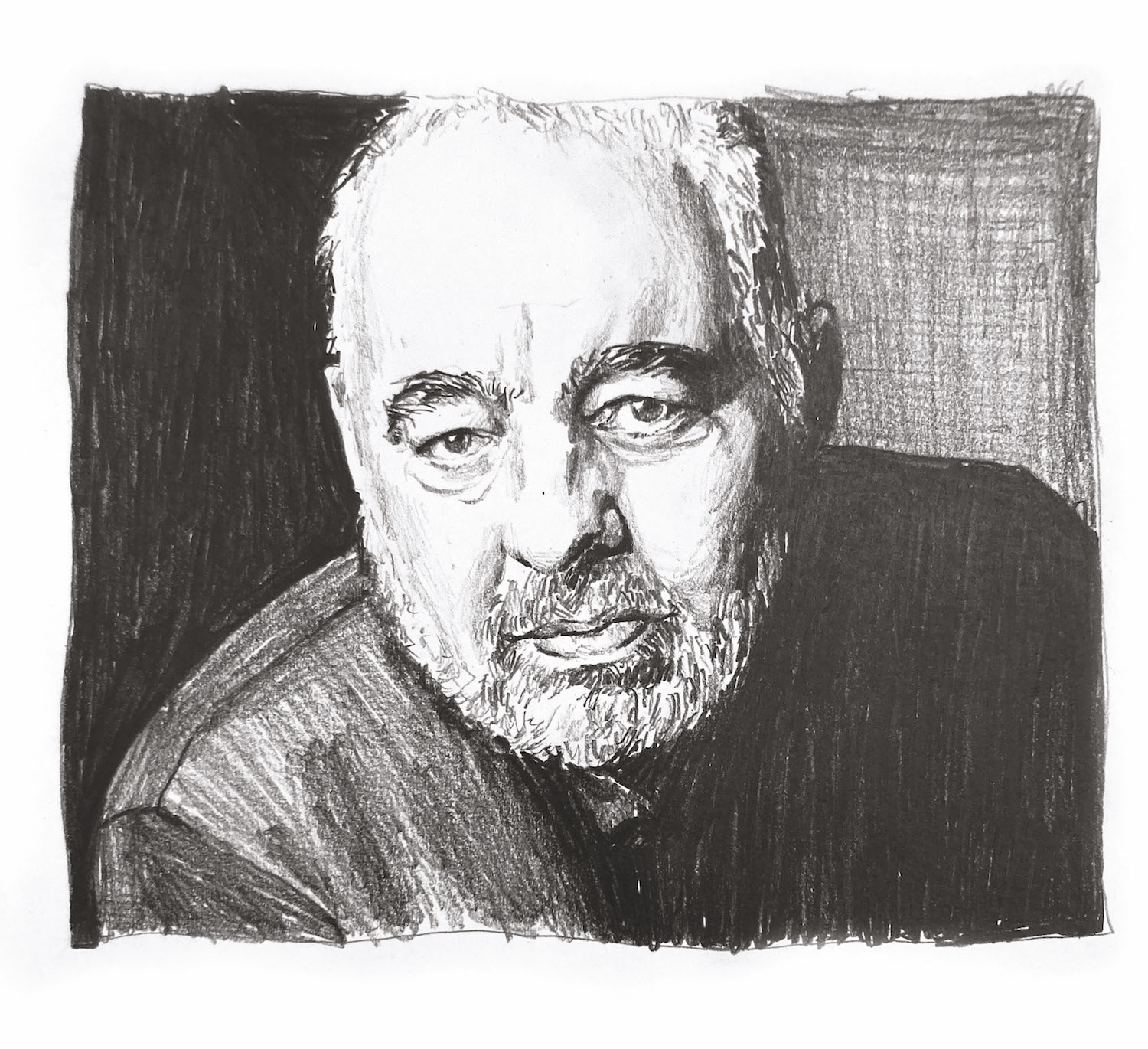
Le rendez-vous était pris au Lafayette, autour de 17 heures. Son QG immuable, à deux pas de chez lui, où il a ses habitudes depuis tant d’années avec son fameux baluchon. Lui, le bourreau de travail qui a longtemps noirci du papier de minuit à huit heures du mat’.
J’ai découvert Philippe Jaenada, comme beaucoup de ses fidèles de la première heure, avec Le Chameau sauvage (prix de Flore 1997), un premier roman d’une drôlerie sans égal, qui a depuis donné son nom à une librairie toulousaine, et qui me le rendit immédiatement sympathique. Un quart de siècle avant de le croiser dans la vraie vie, du côté de Louis Blanc, je fis connaissance de son double loufoque, Halvard Sanz, personnage hors norme, coincé dans une garde à vue d’anthologie et jusqu’à sa rencontre avec le grand amour, une certaine Pollux ! Des situations croquignolesques, qui émailleront ses premiers romans, de La Grande à bouche molle (quel titre!) à l’arrivée de l’enfant (Le Cosmonaute) en passant par des vacances familiales cauchemardesques dans les Pouilles (Plage de Manaccora, 16h30). L’auteur, après avoir détricoté sa vie, décida qu’elle n’avait plus aucun intérêt, du moins pour ses lecteurs. Il se mua soudainement en Rouletabille, autour d’un gentleman cambrioleur-braqueur avec Sulak en 2013 (prix des Lycéennes ELLE 2014). L’homme le plus recherché de France lui apporta la reconnaissance du grand public, élargissant son lectorat de plus en plus accro à chaque nouvelle enquête: La Serpe, son plus grand succès de librairie (prix Femina 2017), et surtout La Petite Femelle (2015), un remarquable plaidoyer en faveur de Pauline Dubuisson, qui donna lieu à une jolie collaboration avec l’artiste Valentine Fournier (cf. page suivante).
« Dès que je m’éloigne
de plus de trois cents mètres
de la station Louis Blanc,
j’ai comme des palpitations… »
Aujourd’hui, l’écriture et la lecture occupent le plus clair de ses journées. Les deux heures quotidiennes passées au bistrot Lafayette, à partir de 17 heures, lui permettent de prendre le pouls du quartier et de tenir sa place de pilier de bar. Ce jour-là, le Lafayette était fermé, pour cause de décès, et j’ai senti Philippe touché par le malheur d’une famille qui est aussi un peu la sienne. À défaut, le Cristal, juste en face, fera l’affaire. Nous déroulons la discussion au sujet de son nouveau livre, pas prévu au programme. Il y a un an, après la sortie de son remarquable pavé Au printemps des monstres, paru dans la nouvelle maison d’édition de ses éditeurs de toujours (Bernard Barrault et Betty Mialet), il avait décidé d’arrêter de passer sa vie dans de copieux dossiers d’instruction. Sans preuve et sans aveu m’a fourni le prétexte de cette nouvelle rencontre. Un livre écrit dans l’urgence, 256 pages comme un coup de poing. Un jour ordinaire de signature, un couple de libraires du cap Ferret lui présente Alain Laprie, un de leurs amis dans la panade, et il est sûr que cette fois il va encore avoir du mal à y couper. L’homme le touche. Philippe accepte de lire son dossier du bout des lèvres, puis une fois plongé dedans, il ne peut plus reculer, l’urgence est là, il va essayer de réparer une injustice. Voilà un noble mobile d’écriture, à défaut de faire de la littérature à tout prix. Oubliées ses fameuses digressions, sa marque de fa- brique, plus de place ni de temps pour la gaudriole, l’heure est grave. Il suit sa conviction intime et découvre un dossier d’instruction mal ficelé exclusivement à charge. L’homme est emprisonné depuis quelques semaines, ce texte n’a d’autres ambitions que de le faire sortir et d’obtenir la révision de son dossier: une situation exceptionnelle mais possible quand un fait nouveau ou un élément inconnu du tribunal surgit après la fin d’un procès. Je m’apprête à le quitter et je lui tends le livre, sacrifiant au rituel de la dédicace. Je sens son embarras, pas ce livre, pas maintenant. Je repars sans ma petite signature mais avec la promesse qu’en cas de libération, je trouverai un nouveau prétexte pour retenter ma chance. Il en faudra beaucoup à Alain Laprie pour que justice lui soit rendue.
Les adresses qui me font aimer le 10eJe suis assez bien placé pour parler du quartier, du moins de la partie dans laquelle je vis, car justement, on peut dire littéralement que j’y vis: je n’en sors presque jamais. Dès que je m’éloigne de plus de trois cents mètres de la station Louis Blanc, j’ai comme des palpitations, le souffle plus court (et au-delà du kilomètre, je tourne des yeux affolés de tous côtés). En dehors de mon appartement, l’endroit – tout proche – où je me sens le mieux, quasiment comme chez moi, c’est le bistrot Lafayette, au 215 de la rue du même nom. C’est pile le genre de bar que j’aime (et qui se fait rare): on y côtoie toute la journée des jeunes, des vieux, des beaux et des moches, des avocates et des plombiers, des flics, des voyous, des profs, des chômeurs, des journalistes, des enfants, des actrices et des comptables, il y a de bonnes choses à boire, à manger, et la bonne équipe derrière le comptoir est souriante et chaleureuse. Je pense que sur mon tabouret, devant mon whisky, j’ai toujours un sourire un peu nouille, je ronronne, à l’aise. Le samedi, par immuable routine, je traverse la rue (je suis un aventurier) et je vais m’asseoir juste en face, au Cristal, où travaille le matin ma belle épouse, Anne-Catherine, et où l’atmosphère et l’équipe sont du même excellent tonneau que de l’autre côté du carrefour. Pour dîner, je suis à peu près aussi peu mobile : je vais en Sicile chez Amore Mio, 31 bis, rue Louis Blanc, où l’on se sent bien et où les pizzas (mais pas que) sont originales et bonnes (un seul défaut: on s’y sent si bien et c’est si bon que, malgré la taille plus que respectable de l’établissement, c’est toujours plein – ces lignes ne vont peut-être pas régler le problème…); et en Chine chez Kim Yang, 40, rue Louis Blanc, notre formidable cantine, à Anne-Catherine et moi-même, dont, depuis vingt ans, jamais on ne se lasse. Enfin deux librairies, bien sûr, entre lesquelles mon cœur balance gaiement: L’Invit à Lire, de son petit nom « Chez Dominique », 12, rue du Château-Landon ; et La Litote, 17, rue Alexandre Parodi. La première est une petite tanière pleine de surprises et de bons conseils ; la seconde est plus vaste et claire: on y trouve tout ce qu’on veut, et surtout du plaisir. Voilà, j’ai fait mon tour, je rentre à la maison – un petit dernier au Lafayette, allez, pour la route. |
Auteur : Michel Lagarde
LA PETITE FEMELLE

La rencontre entre la plasticienne Valentine Fournier et le romancier Philippe Jaenada s’est nouée à partir d’une photo trouvée qui a agit comme un révélateur. Un visage émouvant aux yeux fermés qui réveille la mémoire et enflamme l’imagination de l’artiste, autour de la figure de Pauline Dubuisson, «la petite femelle» du roman.
« Pauline est née le 11 mars 1927, dix mois après Marilyn Monroe, à Malo-les-bains, de Hélène et André. » C’est par ces mots que commence l’histoire de La Petite Femelle de Philippe Jaenada. Je suis plasticienne et la matière première de mon travail est la photo anonyme que je mets en scène, en page, pour créer un nouveau récit. En pleine lecture de ce magnifique livre et quelques heures après avoir lu le passage très émouvant dans lequel l’auteur évoque la photo de Pauline Dubuisson en couverture, je trouve sur un stand de brocante un Photomaton des années 40 d’une jeune femme les yeux fermés. «On dirait qu’elle dort, ou qu’elle est morte », écrit Philippe Jaenada dans son livre. Il devient le personnage de la série d’images que m’inspire ce livre, c’est mon personnage, c’est ma Pauline. Cette série m’a été commandée par l’Intime Festival de Namur, elle a été projetée lors de lectures d’extraits de La Petite Femelle par Philippe Jaenada en 2020 et 2021. Une création sonore que j’ai également réalisée accompagnait les lectures. Une exposition et des lectures ont eu lieu à la galerie Michel Lagarde en mars 2022.
Autrice : Valentine Fournier