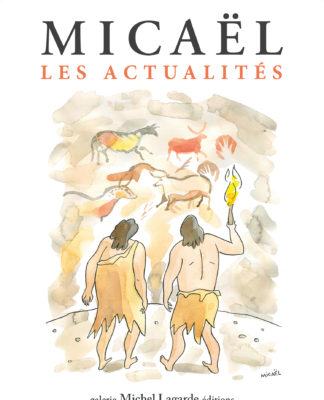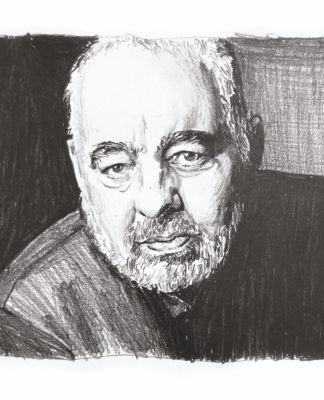Selon Alfred Hitchcock, « la vie ce n’est pas seulement respirer, c’est aussi avoir le souffle coupé ». Nul doute que le musée de l’hôpital Saint-Louis laissera sans voix les amateurs de sensations fortes. On y frissonne de tout son être jusqu’à la chair de poule.
« Oh my God ! » se serait exclamé sir Alfred devant le spectacle offert à ses yeux. La grande salle de 400 m2 expose une collection de trésors dermatologiques unique au monde. Sur les murs, un florilège de bouches, visages, épaules, jambes, organes génitaux… ravagés par la lèpre, les mycoses, le psoriasis, le lupus tubéreux, les verrues, l’éléphantiasis et bien sûr la syphilis. « Classés par ordre alphabétique, depuis l’acné jusqu’au zona », précise Sylvie Dorison, la gardienne du temple. Le lieu, intact depuis le XIXe siècle, semble hanté par ces fantômes du passé. Par contraste, il nous invite à mesurer les miracles accomplis depuis par la science et la médecine. Une piqûre de rappel salvatrice en quelque sorte. L’atmosphère intimiste ajoute au trouble et à la fascination. Le maître du suspense aurait certainement apprécié la mise en scène et le travail de l’éclairagiste. Un décor en trompe-l’œil en réalité, puisqu’il s’agit de moulages en cire, mais si bien imités qu’ils semblent plus vrais que nature. L’illusion est totale. Ainsi, on est bouleversé devant le visage vérolé de cette jeune fille, gracile, qui nous sourit imperceptiblement. « Nous avons ici près de 4 800 moulages reproduisant 200 maladies de peau, commente Sylvie Dorison. Un vrai témoignage de l’histoire médicale. ».
« Ce lieu insolite jouit d’une réputation mondiale. Il attire — en autres — des maquilleurs en effets spéciaux. »
L’origine de cet extraordinaire cabinet des curiosités remonte au début des années 1800. Alphonse Devergie, alors chef de service à Saint-Louis, lègue une collection d’aquarelles qui reproduisent des maladies cutanées. À l’époque, la photographie n’existe pas encore, les planches d’aquarelles ont une vocation pédagogique. L’Assistance publique décide de les exposer dans un musée créé à cet effet. Il ouvre à Saint-Louis en 1865. Peu après, un autre médecin, Charles Lailler (1822-1893), cherche à améliorer le procédé. Il teste différentes techniques qui n’apportent pas satisfaction, lorsqu’un jour, flânant dans le passage Jouffroy, il remarque le travail d’un jeune artisan qui fabrique des fruits en carton-pâte et les colore à la perfection. Charles Lailler propose à Jules Baretta (1833-1923) de faire des essais. Le résultat se révèle surprenant de fidélité et surtout le moulage apporte un relief que l’aquarelle et les autres procédés n’autorisent pas. En 1863, Baretta s’installe à Saint-Louis dans un atelier aménagé au-dessus du musée dont il deviendra vingt ans plus tard le conservateur.
La technique de la céroplastie consiste à mouler les parties malades du corps. Elle est réalisée à partir de patients vivants que le mouleur reçoit dans son atelier. Intervention délicate s’il en est. Dans un premier temps, les lésions du patient sont protégées avec des intestins de bœuf. On coule ensuite dessus un plâtre liquide qui, une fois sec, est retiré avant d’être enduit à l’intérieur de matière grasse. Enfin, on verse une cire chaude. Après séchage peut commencer la coloration, opération destinée à reproduire fidèlement les lésions. Le premier moulage « officiel » est produit en 1867, plus de 4 000 autres pièces suivront. À lui seul, Jules Baretta en réalisera près de 3 500.
La visite se poursuit au premier étage où, tout au long des coursives, sont exposées d’autres collections comprenant principalement des pièces d’enfants ou d’adultes atteints de syphilis. La « grande vérole » figure d’ailleurs au panthéon de ce musée avec 1 200 moulages, rappelle Sylvie Dorison. « C’était l’obsession de l’époque, les Italiens l’appelaient le mal français, les Français le mal de Naples. » Cette maladie très contagieuse, transmise par les prostituées à leurs clients, les maris à leurs femmes, les femmes à leurs enfants, ne sera vaincue qu’avec l’arrivée de la pénicilline au début des années 1940. À ce même étage, les amateurs découvriront des fœtus et un cyclope… baignant dans un bocal de formol.

Ce lieu insolite jouit d’une réputation mondiale. Il attire des visiteurs français ou étrangers, des infirmiers et des médecins mais également des étudiants aux Beaux-Arts ou en architecture. « Et même des maquilleurs en effets spéciaux », précise Sylvie Dorison. De l’extérieur, le bâtiment ne laisse rien paraître des secrets vénéneux qu’il abrite en son sein. La façade, grise, anonyme, se tient à l’écart de la partie moderne de l’hôpital et à proximité de la belle cour car- rée construite au début du XVIIe siècle. Une petite place des Vosges, close et entourée comme un cloître, dans laquelle les pestiférés étaient tenus en quarantaine.
On conseillera aux âmes sensibles de s’abstenir. Elles risquent d’attraper de l’urticaire. Tandis que les autres, une fois passée l’épreuve du feu, se féliciteront de vivre à une époque qui leur épargne les affres de leurs ancêtres. Et c’est tout sourire qu’ils retrouveront la lumière du jour. Bien dans leur peau !
Visites sur RDV uniquement. Renseignements : 01 42 49 49 88
Auteur : Guy Hugnet