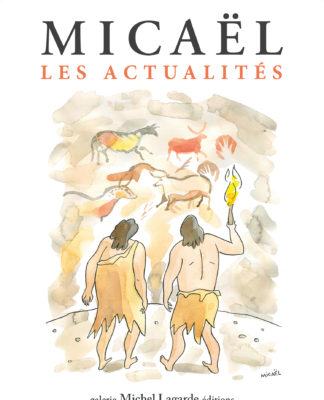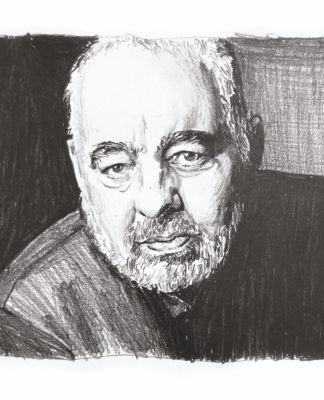22 mars 2020
Je voudrais, depuis mon canapé doux, raconter les beautés du 10e. Donner la lumière du souvenir ; les couleurs joyeuses de ses rues bigarrées. Mais la poétique du coronavirus, pour ceux dont le cœur lourd se sent vibrer d’accents lyriques, c’est peut-être de fermer sa gueule, quand d’autres sont en première ligne de la lutte, de l’angoisse ou de l’inconfort.
Mercredi, c’est une petite attaque de panique qui m’a poussée à sortir. J’ai recopié sur papier libre l’attestation « selon le 1er décret du 16 mars 2020 », comme chacun sait, en précisant qu’il s’agissait d’une sortie « liée à l’activité physique ». Je dirais, me concernant, qu’il s’agissait d’une activité mentale. Une entreprise de sauvegarde. Grand merci, le gouvernement n’interdit pas encore ces sorties dites « de loisir ». J’ai passé la porte.
J’ai marché quelques minutes en direction du canal Saint-Martin. Au début du canal ; près de la place de la République. J’y ai vu quelques joggeurs en tenue de combat ; une ou deux personnes seules, comme moi. Et puis des duos, des trios. Des hommes pour la plupart ; une femme. Tous alcoolisés, ou sous drogue.
Un homme s’approche de moi : « Pense pas au corona ! » D’ordinaire peu sensible à ces accrocs de rue, j’ai ressenti l’envie violente de le frapper. L’angoisse, qui se révèle. J’ai serré les dents. Deux d’entre eux ont escaladé la rambarde du pont pour pénétrer dans le square interdit. Je me suis demandé s’ils pouvaient tomber dans le canal ; ce qu’il faudrait faire à ce moment-là : s’approcher, ou non, appeler les flics, mais combien de temps mettraient-ils à venir ? Et s’il fallait les conduire à l’hôpital ? Tout paraissait possible dans ce contexte. Mais ils ont poursuivi leur chemin. Je me suis assise.
Bien sûr, la gravité des jours n’est pas la même pour tous. Ces hommes et cette femme ne semblaient pas avoir plus que d’ordinaire conscience du monde. Avant la crise. Pour celui ou celle qui est dans une situation sociale ou sanitaire grave, peu importe sans doute que le virus passe par soi ou perde les autres. Le lien avec les proches, compagnons de mauvaise fortune, et l’idée de défier la loi, valorisante peut-être lorsqu’on est au ban de la société, peuvent l’emporter.
Mon rythme cardiaque apaisé, j’ai remonté la rue du Faubourg du Temple. Désormais, distanciation sociale oblige, les passants s’évitent. Mais les regards aussi s’échappent ; les visages sont clos. Mutiques ; presque fantomatiques. La communication s’effrite, et laisse place à une forme d’hébétude. Moi-même, au supermarché, j’ai ressenti la crainte d’attraper le coronavirus en échangeant quelques mots avec la caissière, effarée de la précipitation des clients dans les rayons. « Nous sommes toujours approvisionnés. Il y aura du gâchis », dit-elle dans un sourire de dépit.
Beaucoup le pensent, le monde va se resserrer. Ses pires aspects pourraient devenir plus noirs encore et ses beautés, embryons de relations heureuses ou élans de solidarité, grandir. Aujourd’hui, nous sommes tous tristes. Abattus. En colère. Anxieux. Certains ont perdu des membres de leur famille, craignent pour leurs proches ou pour eux-mêmes. Lorsque nous en avons le luxe, nous nous perdons en séances de yoga, exercices de cardio, lectures diverses et claps quotidiens aux fenêtres. Les échanges numériques vont bon train ; WhatsApp et Facebook n’ont jamais été aussi florissants.
Il y a une chose qui reste précieuse, peut-être : le regard que nous portons aux autres ; et dans lequel tient une part de notre dignité.
Lorsque j’ai eu cette attaque de panique, étrangement, à mon retour ma jeune voisine a frappé à ma porte. J’ai ouvert, malgré tout ; aperçu ses boucles brunes et son sourire. Elle venait me parler – de loin – de la solidarité que nous pourrions mettre en place entre voisins.
« Les pas perdus ? Mais il n’y en a pas. » André Breton, Nadja.
Auteur : Hélène Thomas